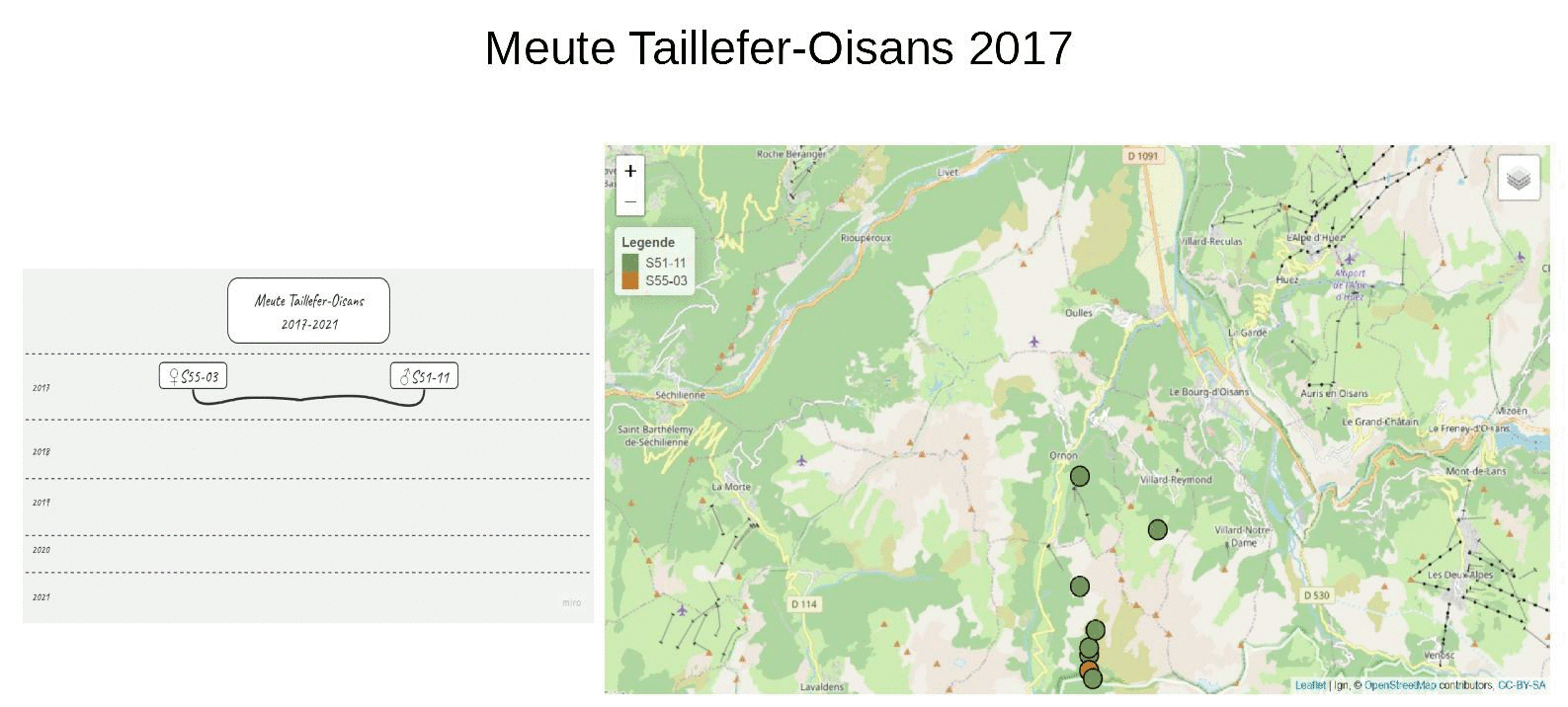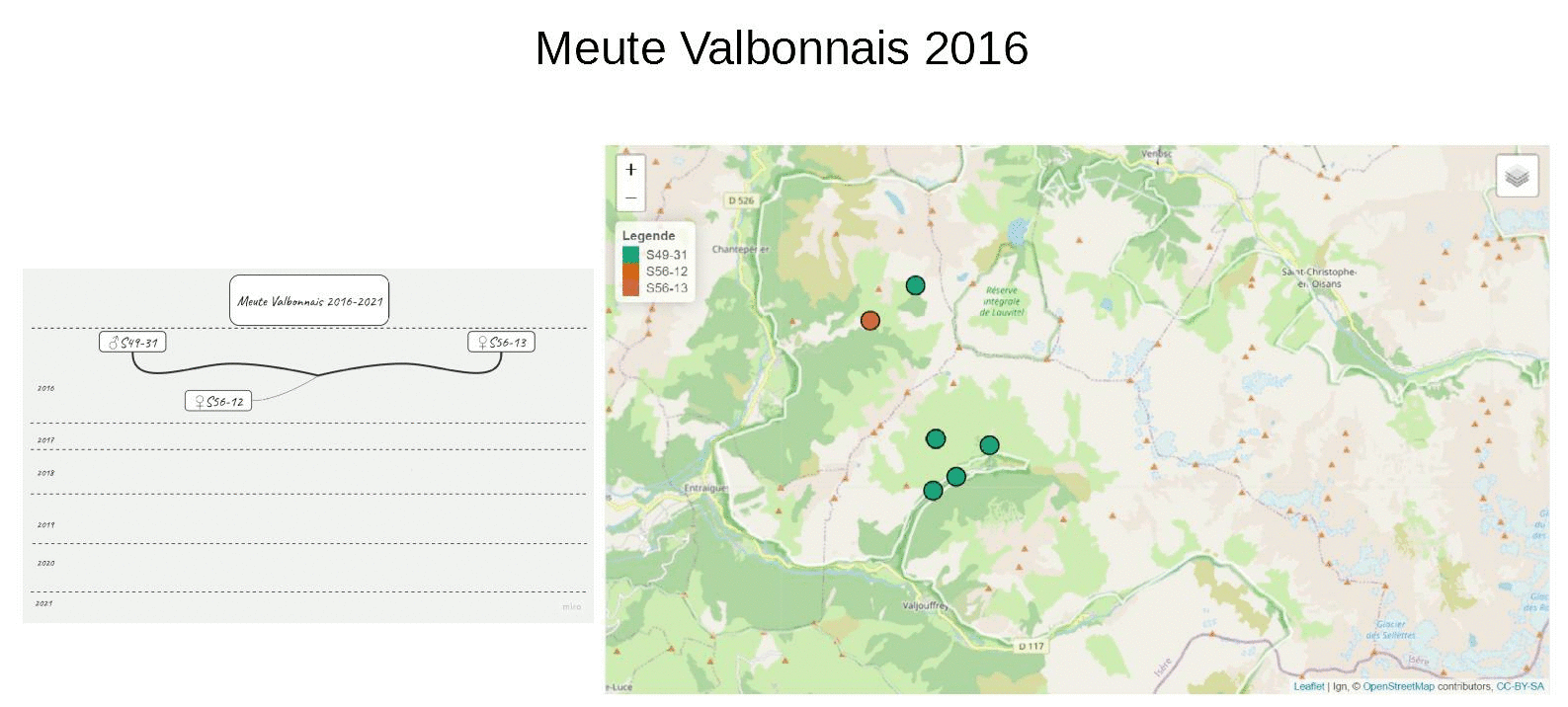C’est quoi le projet LIENS ?
En 2021, le Parc national des Écrins a sollicité le Laboratoire des ÉcoSystèmes et Sociétés En Montagne (LESSEM) de l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement (INRAE) et le réseau Loup-Lynx de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) pour engager une étude visant à analyser l’ensemble des données issues du suivi du loup, de manière à proposer le scénario le plus probable de la recolonisation du massif des Écrins par l’espèce.
Les objectifs affichés étaient donc de comprendre les liens génétiques entre les loups de la population présente dans le parc mais aussi de rendre accessible à toutes et à tous les résultats de cette analyse afin de contribuer à renforcer le lien entre les acteurs locaux et le monde de la science. Le projet LIENS a ainsi vu le jour !
Evolution au fil de l'histoire
Présent historiquement sur l’intégralité du territoire métropolitain, le loup gris d’Europe (Canis lupus) a subi, du Moyen-Âge au 20e siècle, une politique de réduction drastique de ses populations encouragée par l’État français. Ainsi, aux 19e et 20e siècle, l’espèce n’occupe déjà plus que la moitié de son aire historique de présence et cette dernière est considérée comme éradiquée du territoire en 1937.
Figure 1 : Présence du loup en France (1898-1923) - Source : www.loupfrance.fr - Auteur : Francois de Beaufort, 1984
Cependant, si les loups ont totalement disparu du territoire français pendant une certaine période, cela n‘a pas été le cas en Italie où la sous-espèce Canis lupus italicus s’est maintenue dans les Abruzzes (une vaste zone protégée au cœur de l'Italie centrale).
Profitant d’une évolution favorable du contexte juridique et environnemental à la fin du 20e siècle, avec notamment la protection de l’espèce à l’échelle européenne depuis les années 1970, les populations de loups ont peu à peu recolonisé le territoire français.
C’est ainsi qu’en 1992, un premier couple de loups est à nouveau observé en France, dans le parc national du Mercantour (Alpes-Maritimes). Les loups ont alors démarré une phase de recolonisation des habitats favorables à leur présence, à savoir tous les grands espaces naturels (en dehors de la haute-montagne) qui leur permettent de trouver de la tranquillité et des proies en quantité.
En 1997 (après un passage avéré mais ponctuel en 1992) la réapparition du loup a été attestée dans le parc national des Écrins. Depuis lors, l’espèce affirme sa présence dans ce massif avec, petit à petit, une utilisation progressive des secteurs favorables (forêts et moyennes montagnes en priorité).
La mise en récit, que nous vous proposons aujourd’hui, vous permettra de comprendre comment le loup a recolonisé l'ensemble du parc national des Écrins au fil des années, et ce jusqu’en 2021, dernière année pour laquelle les données génétiques sont actuellement disponibles.
Comment les loups ont-ils recolonisé le territoire national depuis leur retour en 1992 ?
En 1992, le couple de loups observé dans le parc national du Mercantour (Alpes-Maritimes) signe le retour officiel de l’espèce en France.
Suite à ce retour, l'État français créée le réseau Loup-Lynx, afin de suivre l’état de la population de loups. Ce réseau de correspondants, aux profils socio-professionnels variés et coordonné par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), assure depuis 1994 un suivi de l’espèce, de manière à documenter régulièrement son aire de présence.
Grâce au travail de terrain de ces milliers de correspondants (plus de 4000 en 2020), il a été possible de suivre la croissance de la population lupine sur le territoire national. Cette croissance s’inscrit plus globalement dans une dynamique de recolonisation des secteurs historiques de présence de l’espèce, et ce à l’échelle de l’Europe.
Représentée sous forme de mailles 10 x 10 km, l'interface ci-dessous vous permet de visualiser l'évolution de la recolonisation de l'espèce depuis 1995 (année du premier bilan national) en France et au sein des secteurs du parc national des Écrins, dans une dynamique allant d'est en ouest et du sud des Alpes vers le nord du massif :
Source : OFB
Des indices de présence dans le parc national des Écrins depuis 1992
Comment détecter la présence des loups ?
 Le loup est une espèce discrète et un nombre réduit d’individus peut occuper de grands territoires (plusieurs centaines de km2) : comment étudier cette espèce ? Le suivi scientifique du loup repose donc notamment sur des techniques éprouvées de recherche sur le terrain, d’indices qui “trahissent” la présence de ce dernier.
Le loup est une espèce discrète et un nombre réduit d’individus peut occuper de grands territoires (plusieurs centaines de km2) : comment étudier cette espèce ? Le suivi scientifique du loup repose donc notamment sur des techniques éprouvées de recherche sur le terrain, d’indices qui “trahissent” la présence de ce dernier.
Ainsi, les correspondants du réseau Loup-lynx (OFB) sont formés à la détection et à l’identification des indices de présence de loup, qu’ils soient directs (observation visuelle, hurlement…) ou indirects (urine, crottes, poils…).
Étudier le nombre de ces indices sur une zone et une période données est un bon indicateur de la présence de l’espèce. Ceci étant, il faut bien garder à l’esprit que le nombre d’indices détectés n'est pas proportionnel au nombre de loups présents sur site et dépend directement de l’effort déployé sur le terrain pour récolter ces derniers (ce que l’on appelle la “pression d’observation”). Pour résumer cet indicateur on pourrait dire : “plus on cherche des indices de la présence du loup, plus on en trouve mais seulement si l’espèce est présente”. On peut déployer une pression d’observation importante et ne rien trouver si l’espèce est absente..
Le suivi des loups dans le parc national des Écrins
 Sur le territoire du parc national des Écrins, le suivi est réalisé majoritairement par les agents de terrain du parc, ce qui permet de disposer, année après année, d’un nombre conséquent de données (cf. figure 2).
Sur le territoire du parc national des Écrins, le suivi est réalisé majoritairement par les agents de terrain du parc, ce qui permet de disposer, année après année, d’un nombre conséquent de données (cf. figure 2).
Dans le parc national des Écrins, le loup fait sa réapparition dans le Champsaur en 1997 (après une détection ponctuelle en 1992 dans le Valgaudemar) et colonise, au fil des années, les autres secteurs. En analysant la dynamique temporelle des indices de présence à l’échelle du massif, on peut distinguer deux points de rupture (les lignes verticales bleues en pointillé sur la figure 2), traduisant à chaque fois le passage à un stade différent dans la recolonisation du territoire par l’espèce. On observe alors trois phases dynamiques différentes :
- 1992 – 2010 : Phase de colonisation : une présence sporadique de l’espèce dans les Écrins;
- 2011 – 2016 : Phase d’installation : de la présence occasionnelle à la présence régulière;
- 2017 – 2021 : Phase de densification : une présence régulière sur tout le territoire du Parc
A noter que les données disponibles pour cette étude l’ont été jusqu’en 2021 ce qui signifie que la phase de densification est peut-être encore en cours actuellement mais nous ne pouvons pas le prouver faute de données plus récentes. Cette phase n’est donc peut-être pas close.
 La figure 3 ci-contre montre la répartition des différents types d’indices de présence qui ont été collectés entre 2017 et 2021 dans le parc national des Écrins. On en distingue huit types qui sont recherchés sur le terrain par les correspondants du réseau Loup-Lynx : observation visuelle, fèces, trace, urine, dépouille, proie sauvage, hurlement et sang.
La figure 3 ci-contre montre la répartition des différents types d’indices de présence qui ont été collectés entre 2017 et 2021 dans le parc national des Écrins. On en distingue huit types qui sont recherchés sur le terrain par les correspondants du réseau Loup-Lynx : observation visuelle, fèces, trace, urine, dépouille, proie sauvage, hurlement et sang.
 Entre 2017 et 2021 (phase de densification de la présence du loup sur le territoire), on note que les indices majoritairement collectés sur le terrain sont, dans l’ordre, les observations visuelles (52,1 %), les fèces (19,9 %) et les traces (15,6 %).
Entre 2017 et 2021 (phase de densification de la présence du loup sur le territoire), on note que les indices majoritairement collectés sur le terrain sont, dans l’ordre, les observations visuelles (52,1 %), les fèces (19,9 %) et les traces (15,6 %).
Il faut bien garder à l’esprit qu’une observation visuelle peut être une observation directe par un humain ou une photographie prise par un piège photographique. En effet, ces derniers sont de plus en plus utilisés par les personnes qui suivent la faune sauvage et les clichés de loups sont donc les indices majoritaires dans notre travail de suivi.
Et la génétique dans tout ça ?
 Certains indices (fèces, urine, sang, poils et dépouille) peuvent être utilisés pour des analyses génétiques. Après avoir été collectés sur le terrain, ces indices biologiques sont transmis au laboratoire partenaire de l'OFB pour le réseau Loup-Lynx (Antagène dans le département du Rhône) afin de vérifier s’ils proviennent bien d’un loup. Si c’est le cas, l’analyse permet pour chaque indice, de déterminer le sexe de l’individu et son génotype si la qualité de l'échantillon le permet. Grâce à ces analyses, il est parfois possible d’obtenir l’identité génétique (le génotype) d’un individu et de pouvoir tester les liens de parenté entre les loups, un peu à l’image de ce que les humains peuvent faire avec un test de paternité.
Certains indices (fèces, urine, sang, poils et dépouille) peuvent être utilisés pour des analyses génétiques. Après avoir été collectés sur le terrain, ces indices biologiques sont transmis au laboratoire partenaire de l'OFB pour le réseau Loup-Lynx (Antagène dans le département du Rhône) afin de vérifier s’ils proviennent bien d’un loup. Si c’est le cas, l’analyse permet pour chaque indice, de déterminer le sexe de l’individu et son génotype si la qualité de l'échantillon le permet. Grâce à ces analyses, il est parfois possible d’obtenir l’identité génétique (le génotype) d’un individu et de pouvoir tester les liens de parenté entre les loups, un peu à l’image de ce que les humains peuvent faire avec un test de paternité.
La figure 4 montre la proportion de ces indices biologiques utilisables en génétique dans le volume total des indices de présence collectés dans les Écrins entre 2017 et 2021.
On peut constater que la part des indices biologiques analysables génétiquement reste minoritaire parmi tous les indices récoltés dans le parc national des Écrins. Malgré cela et grâce au suivi minutieux réalisé chaque année par les agents du Parc, la combinaison des différents indices nous permet de mieux connaître la localisation des meutes de loups sur ce territoire.
Des indices de présence à la représentation des meutes
 Quelques notions sur la biologie des loups sont nécessaires pour comprendre la suite :
Quelques notions sur la biologie des loups sont nécessaires pour comprendre la suite :
Le loup est une espèce sociale qui cherche à s’organiser en meute sédentarisée sur un territoire sur lequel la présence d’individus provenant d’autres meutes ne sera pas ou peu tolérée. Une phase préalable de dispersion est nécessaire pour qu’un loup arrive à trouver une zone favorable et où il n’y a pas encore de meute installée. Ce loup attend ensuite l’arrivée d’un autre loup en dispersion et de sexe opposé pour former un couple que l’on appelle le couple dominant ou alpha. Lorsque ce dernier se reproduit, on appelle meute la structure familiale composée de ce couple et de ses descendants. La meute peut être composée de plusieurs générations de descendants du couple dominant mais la dispersion limite l’augmentation du nombre de loups par meute. En effet, un phénomène de dispersion se met en place au sein de chaque meute lors du printemps et de l’automne. Lorsque les tensions deviennent fortes, certains loups descendants du couple dominant finissent par quitter leur meute d’origine pour disperser afin de trouver un territoire libre puis un partenaire dans le but de créer leur propre meute. La boucle est ainsi bouclée (cf. figure 5).
Ce phénomène de dispersion évite que tous les loups descendants ne s’accumulent au fil des années sur le même territoire, ce qui laisse de la place aux nouveau-nés de la meute. En France et dans les Écrins, une meute est en moyenne composée de 4 à 5 loups au cœur de l'hiver. Elle peut comprendre jusqu’à 10-12 loups en fin d'été et à l'automne où l’effectif peut être plus important puisque les jeunes de l'année sont présents (12 loups sur la meute Taillefer-Oisans en septembre 2018 par exemple).
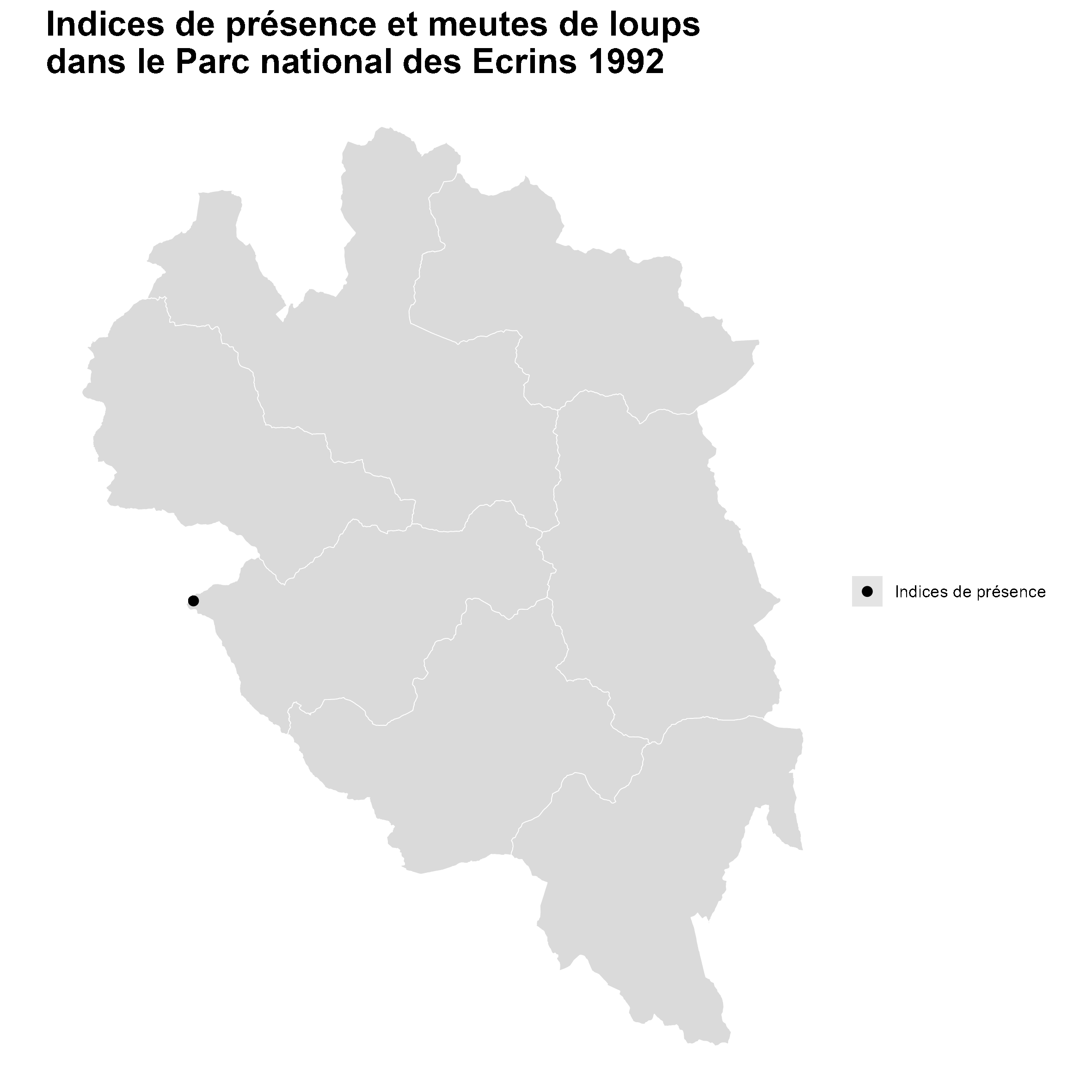 Alors comment fait-on pour différencier les secteurs où une meute est présente des zones où il y a seulement des loups en dispersion - ou même pas de loup du tout - ?
Alors comment fait-on pour différencier les secteurs où une meute est présente des zones où il y a seulement des loups en dispersion - ou même pas de loup du tout - ?
Le réseau Loup-Lynx a créé le concept de Zone de Présence Permanente pour aider à différencier ces différentes possibilités. Le classement d’un territoire en ZPP intervient lorsqu’il est avéré qu'un ou plusieurs loups est/sont sédentarisé(s) depuis au moins 2 ans. On parlera ensuite de “meute” si une reproduction est identifiée ou si le nombre de loups présents est supérieur ou égal à 3 individus. Depuis le retour du loup, les ZPP qui sont partiellement ou intégralement localisées dans le territoire du Parc, ont été identifiées progressivement pour atteindre un total de 16 meutes en 2021 (cf. figure 6).
On arrive à distinguer assez nettement la dynamique de densification du nombre de meutes sur la dernière période 2017-2021. En effet 12 meutes sur les 16 au total ont été mises en évidence sur cette période. C’est bien dans cette dernière phase que le nombre de meutes de loups a considérablement augmenté jusqu’à occuper presque tous les territoires favorables. On peut noter que la majorité du cœur du parc national des Écrins est peu voire pas colonisée par les loups. La présence importante d’écosystèmes rocheux et de haute montagne moins favorables à l’espèce est sûrement un frein à son développement sur cette partie du massif.
 Et si on allait encore plus loin ?
Et si on allait encore plus loin ?
Grâce aux indices biologiques de présence, on peut identifier génétiquement des loups et suivre leurs déplacements dans le temps. A partir d’une méthode qui croise les différentes informations vues précédemment (indices de présence + meutes + génétique) ainsi que l’évaluation à dire d’expert, il est possible d’établir une cartographie des aires de présence utilisées par certaines meutes de loups (celles pour lesquelles nous avons le plus de données). La figure 7 présente ces aires de présence minimales qui correspondent aux zones où, pour une meute donnée, tous les indices ont été détectés.
Précisons que l’aire de présence minimale d’une meute est logiquement plus petite que le territoire que cette dernière occupe en réalité. Il y a en effet forcément des zones où les loups sont allés et où aucun indice n’a été répertorié : le domaine vital d’un individu est impossible à déterminer précisément avec notre méthode de suivi.
Dans le parc national des Écrins, on peut distinguer les aires de présence de onze meutes différentes sur la période 2017-2021 parmi les 16 présentes sur le territoire à ce moment-là. Ce sont les onze meutes pour lesquelles nous avons le plus d’informations génétiques disponibles. Nous n'avons pas assez de données pour représenter les aires de présence minimales des cinq autres meutes. Cette figure donne bien entendu une vision partielle de l’utilisation du territoire par ces meutes mais cela permet toutefois d’aller plus loin et d’être un peu plus précis que les représentations schématiques des indices de présence et des meutes (cf. figure 6).
La dynamique spatio-temporelle des loups dans les Écrins vue par la génétique
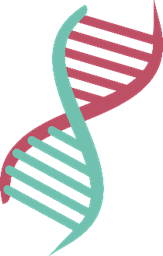
Les différents groupes génétiques dans les Écrins
 Dans cette partie, les données génétiques disponibles sur le territoire des Écrins sont analysées en utilisant la notion de clustering. Le cluster génétique est le résultat d'une analyse scientifique qui permet de mesurer la proximité génétique des individus entre eux sur toute la zone étudiée. Plus ils sont proches, plus ils ont des chances d'appartenir au même groupe. Attention un groupe (ou cluster) génétique n’est pas la même chose qu’une meute. Un animal proche génétiquement d'un groupe existant peut avoir dispersé pour fonder une autre meute ailleurs. Ce type d'analyse vise donc plus à comprendre les dispersions et les sources et origines des colonisateurs au fil du temps, et non une lecture des meutes à l'instant T.
Dans cette partie, les données génétiques disponibles sur le territoire des Écrins sont analysées en utilisant la notion de clustering. Le cluster génétique est le résultat d'une analyse scientifique qui permet de mesurer la proximité génétique des individus entre eux sur toute la zone étudiée. Plus ils sont proches, plus ils ont des chances d'appartenir au même groupe. Attention un groupe (ou cluster) génétique n’est pas la même chose qu’une meute. Un animal proche génétiquement d'un groupe existant peut avoir dispersé pour fonder une autre meute ailleurs. Ce type d'analyse vise donc plus à comprendre les dispersions et les sources et origines des colonisateurs au fil du temps, et non une lecture des meutes à l'instant T.
La figure 8 nous dévoile le résultat de cette analyse. Il a été identifié 7 clusters génétiques différents dans la population de loups des Écrins. Chaque cluster est identifié par une couleur différente.
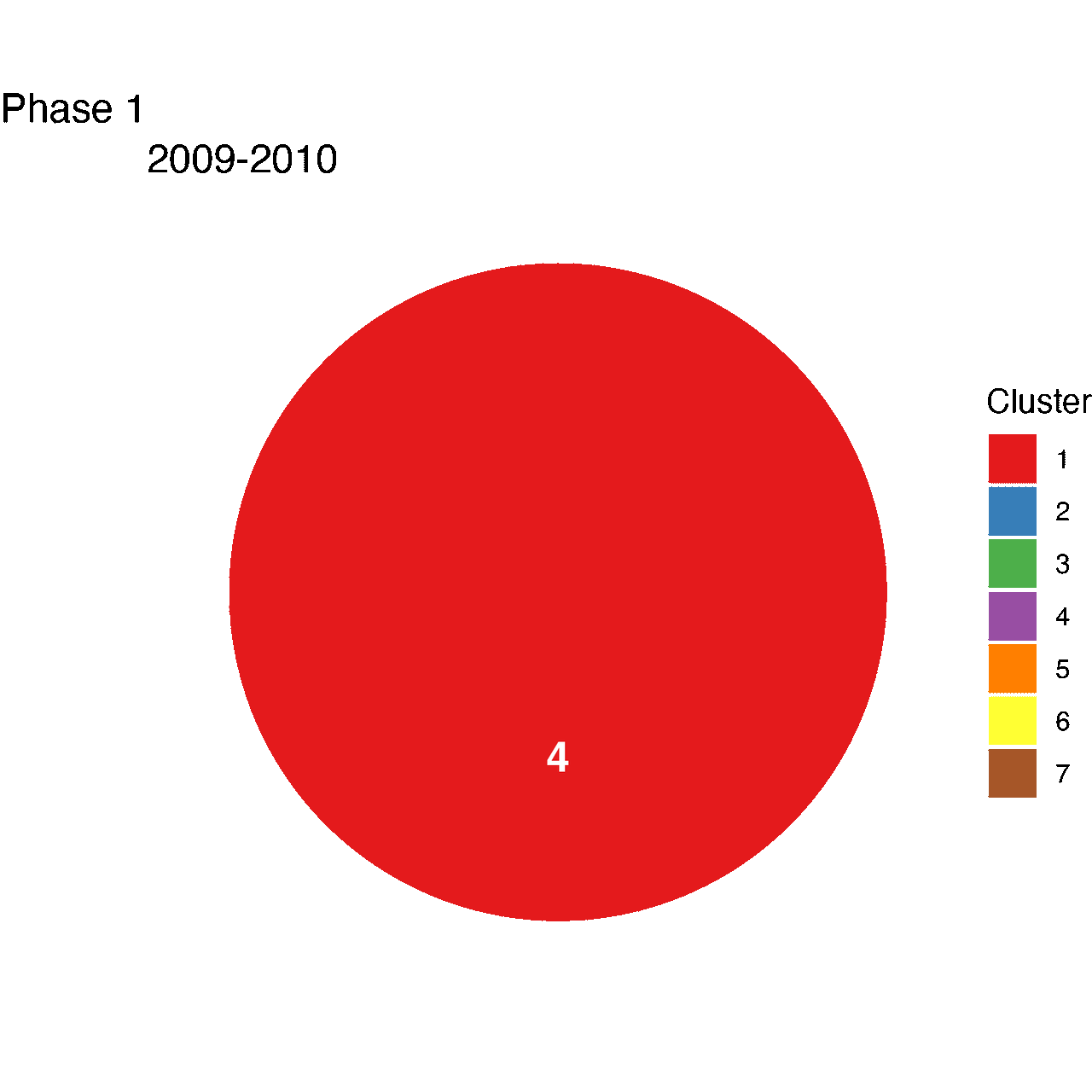 Maintenant que nous avons pu évaluer le nombre de “groupes génétiques” différents, il est intéressant de voir comment ces derniers sont apparus et se sont développés sur le territoire des Écrins.
Maintenant que nous avons pu évaluer le nombre de “groupes génétiques” différents, il est intéressant de voir comment ces derniers sont apparus et se sont développés sur le territoire des Écrins.
Grâce à la figure 9, nous pouvons ainsi observer, année après année, l’apparition et l’évolution de ces clusters :
On peut observer sur cette figure que le groupe génétique historiquement présent sur le parc à partir de l'année 2009 est le cluster rouge et qu’il reste le cluster majoritaire encore en 2021. On constate aussi une diversification des origines génétiques au cours du temps avec de plus en plus d’individus de clusters différents. Cela est expliqué par l’arrivée de nouveaux individus génétiquement différents qui viennent de l'extérieur du massif et qui, en se reproduisant, diffusent leurs gènes. On peut dire que le patrimoine génétique de la population de loups du parc national des Écrins s’est diversifié au cours du temps. Cette diversification est intéressante pour cette population car un patrimoine génétique peu diversifié peut induire des risques de consanguinité. Au contraire, une population avec un patrimoine génétique diversifié sera plus résistante aux maladies et à tout changement de son environnement. Ainsi, plus la diversité génétique d'une population est importante plus cette dernière a des chances d'exister longtemps et de survivre aux perturbations de son milieu.
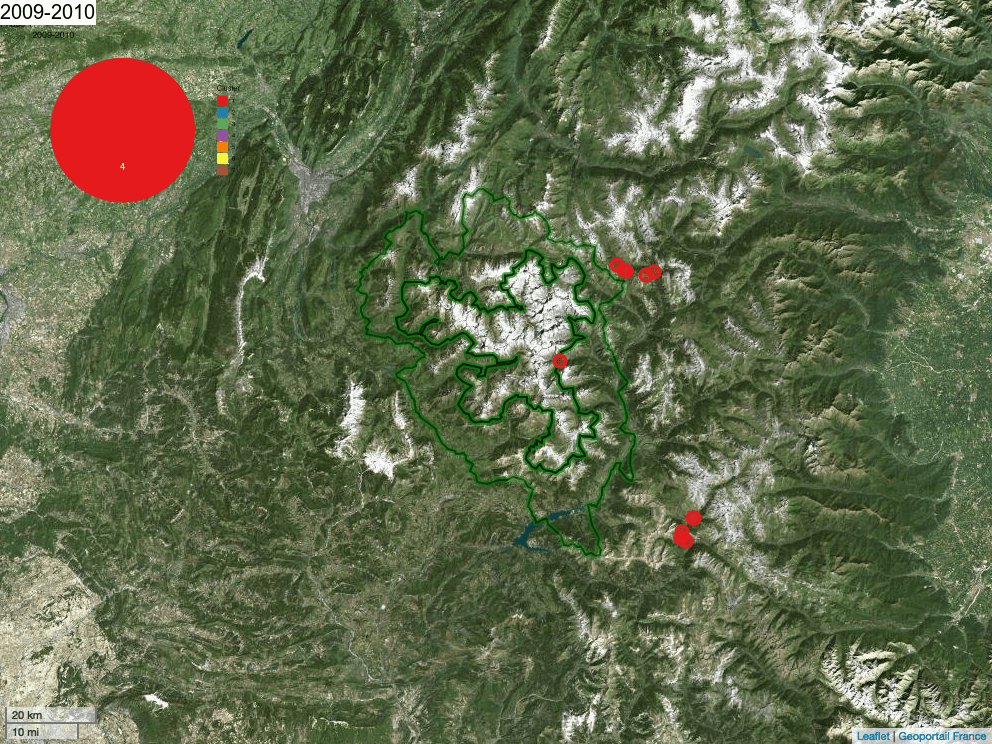 Pour que cela soit plus visuel, nous vous proposons maintenant avec la figure 10, une cartographie animée montrant le nombre et la localisation des loups (dont la signature génétique a été détectée au minimum 2 fois) classés par cluster génétique dans les Écrins sur la période 2009-2021. Vous pouvez ainsi observer l’apparition et l’évolution des différents “groupes génétiques” au sein du territoire.
Pour que cela soit plus visuel, nous vous proposons maintenant avec la figure 10, une cartographie animée montrant le nombre et la localisation des loups (dont la signature génétique a été détectée au minimum 2 fois) classés par cluster génétique dans les Écrins sur la période 2009-2021. Vous pouvez ainsi observer l’apparition et l’évolution des différents “groupes génétiques” au sein du territoire.
Un cercle représente un indice et non un individu et de ce fait, un même individu peut apparaître plusieurs fois. La couleur du cercle renseigne l'appartenance à un cluster génétique.
Application GénétLoupExplorer
Il vous est possible de “prendre les commandes” via l’interface GénétLoupExplorer pour visualiser toutes les données génétiques disponibles pour la population de loups dans les Écrins entre 2002 et 2021. Chaque cercle correspond à une localisation d’un loup à la suite d’une analyse génétique d’un indice biologique collecté sur le terrain. La couleur du cercle correspond à l’appartenance à un cluster. Si vous passez votre curseur sur le cercle, vous pouvez voir le numéro de la signature génétique du loup (c’est un peu son petit “nom”). Choisissez votre année de départ avec le curseur du haut puis choisissez la durée sur laquelle vous voulez voir les données apparaître avec le deuxième curseur “Durée”. Le troisième curseur vous permet de choisir le nombre minimum de fois où un loup a été détecté. Si vous choisissez un nombre élevé (8, 9 ou 10), vous avez de très fortes chances de visualiser les loups dominants des meutes. En effet, ce sont eux qui restent le plus longtemps sur leur territoire (sauf cas de mortalité). Ils ont aussi une tendance naturelle à déposer des fèces ou de l’urine pour marquer plus souvent leur territoire que les autres membres de la meute.
Source : BD Indices, Réseau Loup-Lynx / OFB / Parc national des Écrins - 2022
Une fois les données affichées sur la carte, vous pouvez naviguer et zoomer dans la carte à l’aide de votre souris.
N’hésitez pas à jouer avec les curseurs pour voir toutes les possibilités offertes par cette application et immergez-vous dans la dynamique spatio-temporelle de la population de loups du massif des Écrins.
De la génétique à la généalogie des meutes
Lorsqu’il y a beaucoup de données génétiques disponibles sur une meute donnée, il est possible de les analyser pour tenter d'identifier des liens de parentés entre les individus.
Des outils mathématiques sont utilisés pour détecter des probabilités de liens génétiques entre les loups et l'expertise des agents de terrain permet de confirmer ou d'infirmer une hypothèse. Par exemple, un loup qui est détecté beaucoup de fois en peu de temps (fèces, urine etc..) a de plus fortes chances d’être un dominant qui marque souvent son territoire.
C’est l’échelle la plus fine à laquelle nous pouvons aller mais c’est aussi celle qui est la plus délicate car on recoupe des calculs numériques et l’expérience des agents de terrain. La fiabilité de ces “arbres généalogiques” est donc à considérer avec une grande précaution.
Malgré tout, nous vous proposons de découvrir les liens de parenté les plus probables sur plusieurs années dans 2 meutes différentes présentes sur le territoire des Écrins (cf. figures 11 et 12). Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à vous amuser à rechercher, dans l’application “Loup Écrins Génétique”, les différents individus dont on parle ici !
Cas de la meute Taillefer-Oisans
En 2017, un couple de loups est suivi par les agents du Parc puis identifié génétiquement sur le territoire Taillefer-Oisans : S55-03 (femelle) et S55-11 (mâle).
Dès l’année suivante, la reproduction de ces deux loups est constatée sur le terrain avec l’observation de louveteaux. Quatre nouveaux génotypes sont identifiés sur ce même territoire cette année-là. Après avoir analysé les liens de parenté, ces génotypes S58-49, S55-02, S63-44 et S58-50 seraient vraisemblablement des loups issus d’une reproduction du couple alpha identifié en 2017. Vous pouvez les retrouver dans l’arbre généalogique (cf. figure 11) comme descendants potentiels détectés une première fois en 2018.
En 2019, quatre nouveaux génotypes sont détectés S64-17, S62-15, S64-45 et S60-23, avec les caractéristiques génétiques des descendants de S55-03 et S55-11.
En 2020, aucun nouveau génotype n’est identifié sur ce territoire alors qu’en 2021, on observe de nouveau trois génotypes de descendants potentiels du couple dominant : S74-075, S73-011 et S74-076.
Information intéressante : tous les loups identifiés génétiquement comme descendants ne s’accumulent pas au fil des années sur le même territoire. En effet, le phénomène de dispersion vu précédemment, facilite le départ de la plupart des loups nés les années précédentes.
Figure 11 : Identification des liens potentiels de parenté au sein de la meute Taillefer-Oisans - Source : BD Indices, Réseau Loup-Lynx / OFB / Parc national des Écrins - 2022
Cas de la meute Valbonnais
En 2016, trois loups sont identifiés génétiquement sur le territoire de Valbonnais : S49-31, S56-13 et S56-12.
En se basant sur le nombre plus conséquent d’excréments déposés par ces individus, on fait l’hypothèse que le couple dominant est composé de la femelle S56-13 et du mâle S49-31. Hypothèse qui se vérifie puisque la signature génétique de ces deux individus est présente jusqu’en 2020 sur ce même territoire. On identifiera au fil des années et des reproductions successives jusqu’à quinze individus descendants vraisemblablement de ce couple. En parallèle de ces analyses génétiques et de leur interprétation, des indices de reproduction ont été détectés sur ce territoire par les agents du Parc en 2016, 2017, 2018 et 2019.
Figure 12 : Identification des liens potentiels de parenté au sein de la meute Valbonnais- Source : BD Indices, Réseau Loup-Lynx / OFB / Parc national des Écrins - 2022
Conclusion
Le projet LIENS nous a permis de comprendre un peu mieux le déroulement de la recolonisation des loups dans ce magnifique territoire qu’est le parc national des Écrins. Après un passage ponctuel de l’espèce en 1992 puis une présence avérée à partir de 1997, l’analyse de toutes les données disponibles met en lumière une dynamique inscrite en trois phases principales :
- 1992-2010 : une phase de colonisation où le loup a été présent de façon sporadique à l’échelle des Écrins. On y observe des passages d’individus d’un seul “groupe génétique”.
- 2011-2016 : une seconde phase d’installation où les premiers loups s’installent, ensuite rejoints par d’autres. Les premières meutes sont ainsi créées et les premières reproductions sont détectées (Champsaur, Guisane, Beaumont-Valgaudemar). On passe ainsi d’une présence occasionnelle de l’espèce à une présence régulière sur l’ensemble des secteurs du parc. On a pu observer une réelle diversification du patrimoine génétique de la population avec l’arrivée de nouveaux individus apportant avec eux des gènes différents de ceux déjà présents sur le territoire. Lors de cette phase, cinq clusters génétiques différents ont été détectés sur le massif.
- 2017-2021 : une phase de densification où de nouvelles meutes de loups se sont installées (Valbonnais, Morgon, Taillefer-oisans, Queyrel, Vénéon, Vallouise, Chabrières, Fouran, Romanche, Grandes Rousses, Rousses-Sarenne) sur la quasi-totalité des territoires jusqu’à présent inoccupés, pour arriver à une occupation presque intégrale du massif à l’exception du centre du massif (zone de haute montagne). En parallèle, les autres meutes déjà présentes ont continué à se reproduire et le patrimoine génétique a continué à se diversifier mêlant les gènes des individus déjà présents à ceux des nouveaux arrivants. Le nombre total de sept clusters génétiques différents a ainsi été atteint lors de cette période. Bien que les données génétiques ne soient pas encore disponibles pour les années 2022 et 2023, le suivi réalisé et les retours de terrain permettent de dire que nous sommes probablement toujours dans cette même phase actuellement.
D’ailleurs, il serait intéressant de continuer à utiliser cette méthode à l’avenir, pour voir si la phase de densification se poursuit ou si une nouvelle phase de stabilisation ou de régression se met en place à l’échelle du parc national des Écrins.
Le loup est une espèce compliquée à suivre de par sa nature discrète. Les correspondants locaux du réseau Loup-lynx et les agents du Parc national des Écrins déploient une énergie considérable à suivre l'évolution spatiale de l'espèce et l'identification des nouvelles meutes depuis son retour sur le territoire. L’équipe du projet LIENS espère que cette analyse aura permis de valoriser tout le travail issu de cette énergie. On espère également que le "voyage numérique" que nous vous avons proposé, de l’échelle nationale à l’échelle d’une meute, vous aura permis de découvrir à la fois les méthodes de suivi mises en place, la complexité d’une telle étude ainsi que les incertitudes qui demeurent malgré tout. On espère aussi que cela vous aura permis de mieux comprendre où se répartissent les loups et comment ils ont évolué au cours du temps dans les Écrins.
Lexique
- Dépouille : Il s’agit d’un cadavre de loup. Il est soit retrouvé sur le terrain de façon opportuniste, soit issu d’un tir réglementaire (tir de défense des troupeaux ou tir de prélèvement). Un fragment de muscle est ensuite envoyé pour analyse génétique afin de déterminer le génotype du loup associé grâce à l’ADN contenu dans l’échantillon.
- Fèces : Il s’agit d’un excrément d’un loup prélevé sur le terrain. Cet indice est ensuite envoyé pour analyse génétique afin de déterminer le génotype du loup associé grâce à l’ADN contenu dans l’échantillon.
- Hurlement : Cet indice correspond à un ou plusieurs hurlements de loup(s) entendus par un correspondant du réseau Loup-lynx.
- Observation visuelle : Cet indice correspond soit à une observation faite directement par un correspondant du réseau Loup-lynx, soit à un témoignage recueilli par un correspondant, soit à une photo issue d’un piège photographique.
- Proie sauvage : Il s’agit d’une proie sauvage qui a été prédatée par un ou plusieurs loups et qui a été expertisée ensuite par un correspondant du réseau Loup-lynx pour définir si le loup est bien responsable de cette prédation.
- Sang : Cela correspond à un échantillon de sang (sous forme de gouttes ou tâches suite à une blessure ou lors des chaleurs de la femelle alpha) de loup prélevé sur le terrain par un correspondant du réseau Loup-lynx. Cet indice est ensuite envoyé pour analyse génétique afin de déterminer le génotype du loup associé grâce à l’ADN contenu dans l’échantillon.
- Trace : Cet indice correspond à une piste de plusieurs empreintes (dans la boue ou la neige) d’un ou plusieurs loup(s) détectée sur le terrain par un correspondant du réseau Loup-lynx.
- Urine : Il s’agit d’un prélèvement sur le terrain (dans la neige le plus souvent) par un correspondant du réseau Loup-lynx. Cet indice est ensuite envoyé pour analyse génétique afin de déterminer le génotype du loup associé grâce à l’ADN contenu dans l’échantillon.
- Génotype : Il s’agit de la signature génétique qui permet d’identifier un loup grâce à des analyses génétiques d’un échantillon biologique. Cette signature est représentée par la nomenclature SX-Y où X est un nombre représentant le numéro de la Session d’analyses génétiques en laboratoire et Y un nombre qui représente le numéro du génotype découvert lors de cette session. Par exemple, S49-33 correspond à un génotype découvert pour la première fois en 33e position lors de la 49e session d’analyses génétiques.
- Point de rupture : Cette notion fait référence à un changement assez brutal de dynamique de l’espèce à une échelle donnée (meute, secteur ou massif). Cela peut donc correspondre à une forte hausse ou une forte baisse des indices de présence. Dispersion : Le plus souvent cela correspond à la phase où un jeune loup (1-3 ans) quitte la meute dans laquelle il est né pour aller s’installer sur un autre territoire. Cette dispersion peut s’étendre de quelques kilomètres à plus d’un millier de kilomètres. Elle peut aussi être rapide ou durer plusieurs années.
- Évaluation à dire d’expert : On se base sur le regard et l’expérience des personnes qui réalisent régulièrement le suivi sur le terrain pour vérifier les résultats obtenus dans les analyses. Cela permet de ne pas tomber dans le piège d’être hors-sol ou trop théorique.
- Aire de présence minimale : C’est l’aire minimale dans laquelle nous sommes sûrs que les loups d’une meute ont évolué dans la période étudiée. Elle correspond à une partie du territoire complet de la meute.
- Domaine vital : Correspond au territoire d’un individu ou d’une meute. C’est la zone qui est habitée par un individu durant sa vie d’adulte ou par une meute lorsqu’elle est organisée et sédentaire.
- Cluster génétique : Au sein d’une même zone, c’est un regroupement d’individus ayant des caractéristiques génétiques plus proches entre eux qu’avec le reste des autres individus. La taille et le nombre de clusters dépend de la distance génétique qui est prise comme valeur limite. Si la distance choisie est grande, le nombre d'individu par cluster (regroupement) est grand, et le nombre de clusters est petit ; inversement si la distance choisie est faible.
- Patrimoine génétique : Ensemble des gènes présents chez un individu ou plusieurs individus (population).
- Consanguinité : Lien entre des individus ayant un ou des ancêtre(s) proche(s) en commun. Elle a pour effet d'accroître le risque de maladie génétique pour les individus concernés et de limiter la capacité d'adaptation de l’espèce à une perturbation (maladies).